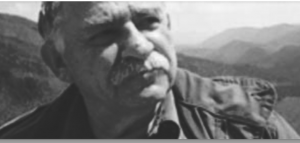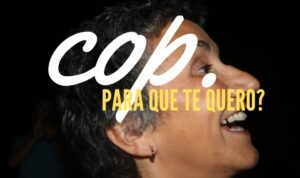“Sou português, dramaturgo, encenador, também director do grupo de teatro A Barraca com Maria do…
Polémica
Murray Bookchin que pode ser descrito como o pai do municipalismo libertário. A sua teoria…
Essa greve dos caminhoneiros já entra para a história como a mais onerosa para o…
Foi um politólogo americano, Joseph P. Overton, quem criou um novo conceito sobre os discursos…